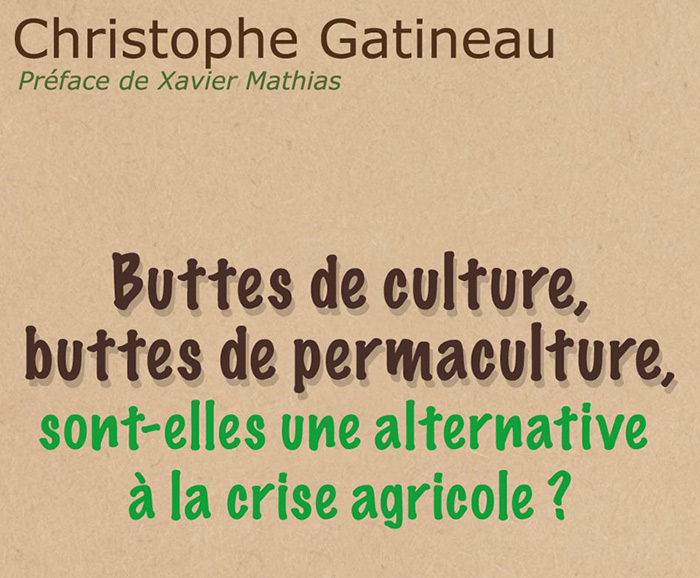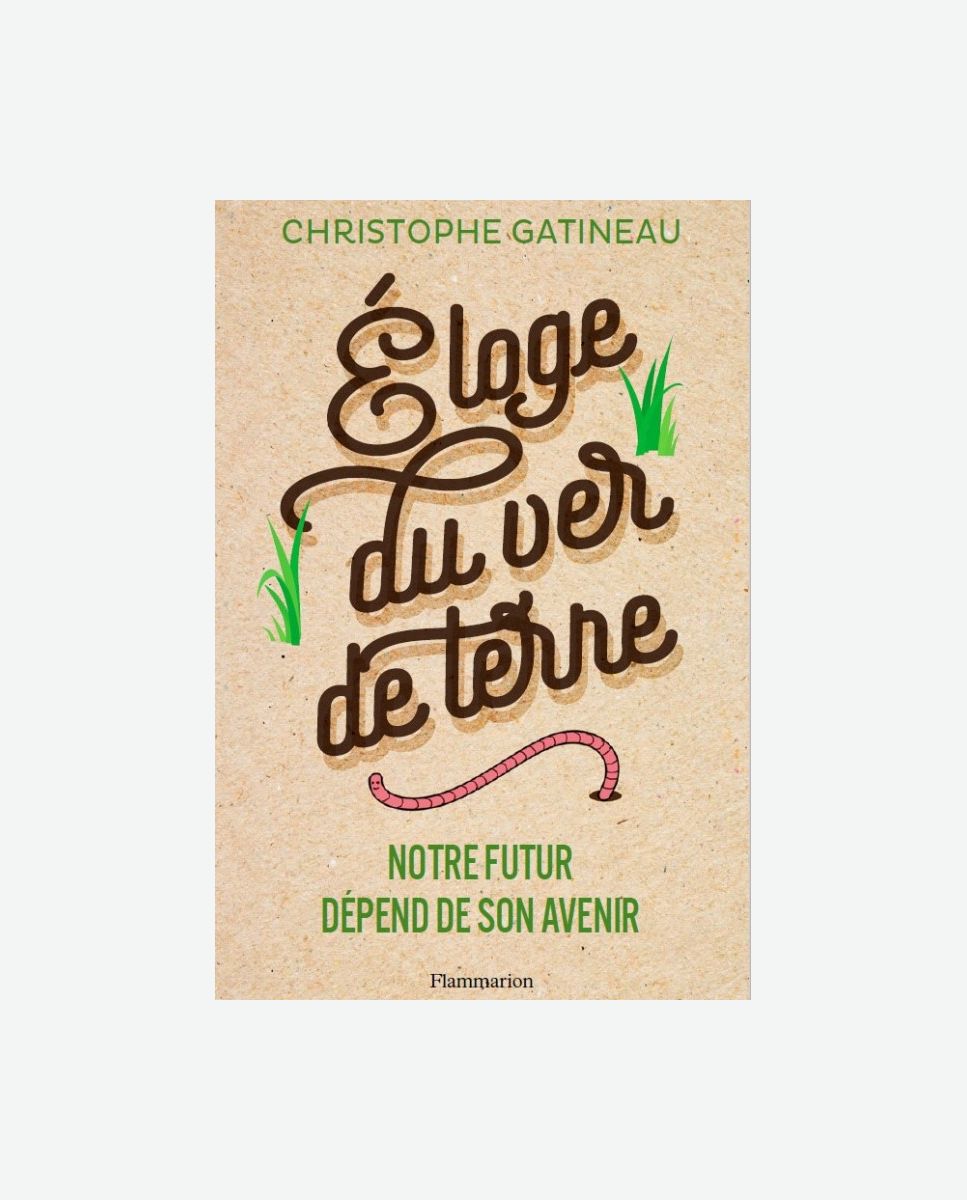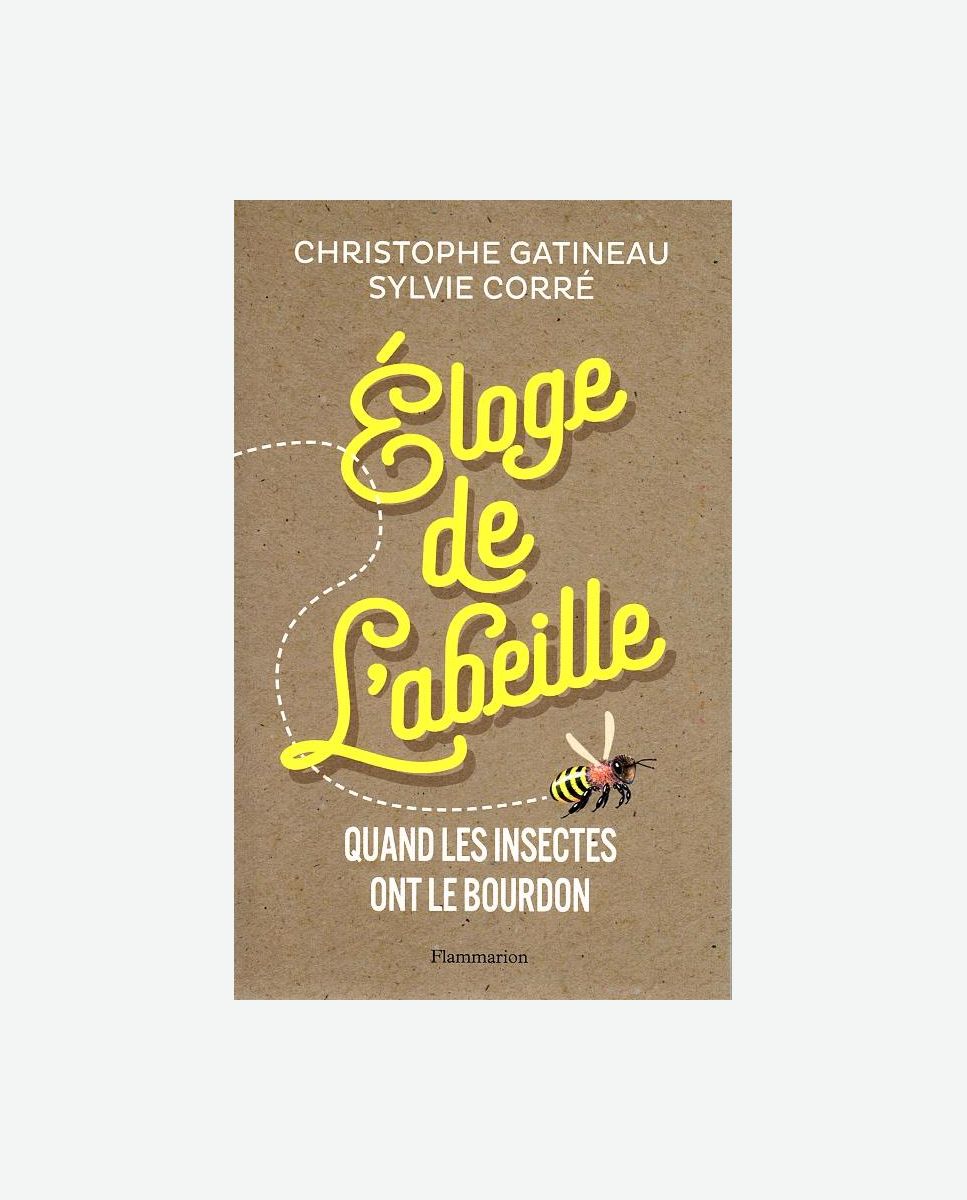SYNTHÈSE DE L’APPEL À PARTICIPER À UNE EXPÉRIMENTATION PHYTOSANITAIRE : LE SAVON NOIR CONTRE LA CHENILLE DE LA PIÉRIDE DU CHOU
À la source, un article publié en 2013 sur ce blog :
Extraits : « Nous avons récemment épandu du savon noir dilué sur des choux très fortement attaqués par des chenilles de la piéride du chou. Le seul objectif de cet essai était d’observer leurs réactions ; la même expérience sur de petites limaces n’avait eu aucun effet. »
« Lors de cet essai, toutes les chenilles de la piéride du chou touchées par contact lors de pulvérisation, ont été prises de convulsions violentes. Moins de 30 minutes après, plus de 50 % étaient mortes : un résultat totalement inattendu pour une efficacité spectaculaire et bien supérieure à la célèbre bactérie [Bacillus Thurigiensis]. »
En lutte biologique contre cette chenille, les moyens sont limités. Outre de favoriser ses prédateurs naturels, de poser des filets de protection ou de les détruire manuellement, en dehors, seul le BT règne en maître, vendu sans vergogne hors de prix. Pour le jardinier amateur cultivant moins d’une douzaine de choux, la méthode la plus écologiquement responsable, est le ramassage manuel des chenilles et la capture des papillons avec un filet.
1 – synthèse de l’appel
2 – le savon noir interdit en AB
3 – il y a savon noir, et savon noir…
4 – les répulsifs de la piéride
Synthèse
Tous les retours suite à la publication de l’article, valident à 100 % nos observations et l’effet « chenillicide » du savon noir dans la lutte contre ce ravageur des cultures. C’est un grand pas car outre d’être très bon marché, le savon noir est dans sa recette traditionnelle, 100 % biodégradable.
- Agit uniquement par contact
- Nécessite 2 pulvérisations à 24:00 d’intervalle
- Utilisation d’un pulvérisateur à buse fine pour créer un brouillard fin
Dosage : une cuillère à soupe de savon noir dosé à 40 % par litre ou 3 cuillères à soupe pour la version liquide titrée à 15 %
Cibles observées
- Chenille de la piéride du chou
- Chenille processionnaire du pin
- Cochenille du citronnier
- Cochenille blanche du dattier
- Puceron noir
- Contrarie le développement des populations d’altise
- Totalement inefficace comme fongicide
Autres observations
- Précautions d’emploi relatives à l’usage des détergents.
- Aucun impact observé sur la saveur.
- Ne pas consommer les quelques feuilles extérieures.
2 – le savon noir interdit en AB
Tous les savons noirs sont interdits en agriculture biologique certifiée AB. Et les fabricants et les commerçants qui mentionnent qu’il est un « produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE n°… » sont en tord avec la législation.
En AB, seul le sel de potassium des acides gras (savon mou) est autorisé en tant qu’insecticide. Et le savon mou, c’est du savon noir dans sa recette la plus traditionnelle : une émulsion forcée à chaud de deux liquides non miscibles, un corps gras et une base alcaline. Mais quand cette émulsion est vendue comme du savon noir, elle est interdite, puisque le savon noir est un détergent.
Les normes de la CEE en Agriculture Biologique sont à l’image de ses institutions : sombres et impénétrables.
Piffard 1881 : « Le savon noir est un savon mou qui utilise comme réactif la potasse, l’hydroxyde de potassium, dont les cendres de bois sont très riches. Un savon noir à point doit être plus épais qu’un sirop pour ne pas couler quand on retourne le pot »
3 – il y a savon noir, et savon noir…
Même quand ils sont certifiés Écocert, tous ne sont pas écologiques. En effet, le savon noir obéit à la législation sur les détergents.
En pratique, quand un fabriquant se vante que son savon noir est biodégradable, cela veut dire qu’il est biodégradable à 70 % au bout de 28 jours. Et pour les 30 % restant, il n’a aucune obligation.
Mieux, comme il y a autant de formules de savons noirs que de fabricants, si le fabricant ne garantit pas que son savon noir est 100 % biodégradable, c’est qu’il peut contenir des additifs chimiques non biodégradables et potentiellement toxiques pour l’environnement.
En bref, le chouchou de l’écolo citoyen est vendu comme un produit d’entretien et non comme un produit phytosanitaire. Motif pour lequel il est interdit en AB quand il est nommé Savon-noir. En plus, les lessiviers n’ont aucune obligation à communiquer sa composition, sauf quand il est certifié Écocert. Et même si la certification garantit une meilleure transparence, n’empêche que le savon noir vendu pour du savon noir reste soumis à la législation sur les détergents et de sa non-obligation de biodégradabilité à 100 %.
Nb : nos essais avaient été réalisés avec le savon noir BRIOCHIN, un savon certifié Écocert et garantit par son fabricant 100 % biodégradable. Mais un fabriquant qui se désintéresse totalement des applications phytosanitaires de son savon !
Liste complète des entreprises proposant des savons noirs liquides ou solides certifiés Écocert : COSMETIQUE-DETERGENT-SAVON-C.D.S, SDEB – ECODIS, HARRIS (Briochin), SARL RAMPAL LATOUR, DISTRINAT, SARL COMPTOIR DES LYS, SA LA VIE CLAIRE et EURONAT
4 – les répulsifs de la piéride
Un répulsif sert à éloigner et à repousser l’ennemi, à le repousser chez le voisin, sauf si le voisin emploie lui-même un répulsif. Au bout du compte, si tout le monde utilise un répulsif, le papillon n’aura pas d’autres possibilités que de pondre sur les choux de là où il est né. L’idée d’utiliser un répulsif est donc excellente si vous êtes le seul à l’employer.
C’est tout bête. Son truc à la piéride du chou, c’est le chou. Elle est obsédée par l’idée de pondre sur une feuille de choux. Si elle s’était appelée la piéride du cornichon, n’importe quel cornichon aurait compris que ….
En revanche, cette idée appliquée aux larves est stupide. Personne n’a pu observer à ce jour une colonie de chenilles de la piéride migrer par la route d’un champs vers un autre champs. Les seules migrations observées ont été de les voir rejoindre le choux d’à coté… Une fois qu’elles ont terminé de dévorer leur choux hôte.
Repousser les larves hors de là où elles sont nées est donc une aberration.