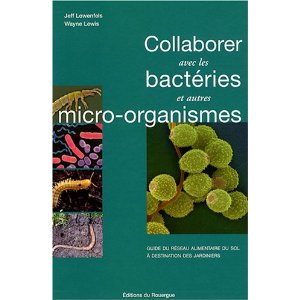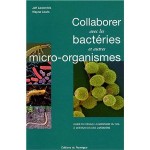Article invité écrit par Loïc Vauclin du blog mon potager en carré.
Comme je vous l’ai déjà évoqué dans la présentation de mon potager en carré, ma terre était plutôt du genre stérile et très sableuse. Les 2 premières années de culture traditionnelle à plat m’ont plutôt découragées. Seulement l’échec est un moteur chez moi, j’aime bien contourner les problèmes et les solutionner. C’est l’expérimentation qui permet de trouver des solutions. Expérimenter c’est aussi prendre des risques. Seulement il faut bien admettre que les risques pris en tant que jardinier sont plutôt réduits. Le principal est celui de travailler au jardin sans obtenir la moindre récolte. Mais parfois on fait des découvertes intéressantes. En voici quelques une qui me concernent.
Un légume se ressème ?
 En appliquant les conseils que j’ai glanés sur internet, j’ai étalé la totalité de mon bac à compost sur mes carrés de potager et sur quelques planches de culture. Ma surprise fut de récolter des pommes de terre genre vitelotte et des tomates sans avoir semé quoique ce soit. Je ne sais pas pourquoi mais j’avais l’à priori que l’on ne pouvait pas utiliser les graines de ses propres légumes pour faire des semis. A vrai dire je n’avais même jamais pris le temps d’y réfléchir. Et chaque année je ne manque pas de faire chauffer ma carte bleue dans les jardineries pour acheter des graines. Aujourd’hui je me demande bien comment ce genre d’idée a pu germer dans ma tête. Surtout que je ne suis pas le seul dans ce cas ! Y aurait-il un travail de lobbying là derrière ?
En appliquant les conseils que j’ai glanés sur internet, j’ai étalé la totalité de mon bac à compost sur mes carrés de potager et sur quelques planches de culture. Ma surprise fut de récolter des pommes de terre genre vitelotte et des tomates sans avoir semé quoique ce soit. Je ne sais pas pourquoi mais j’avais l’à priori que l’on ne pouvait pas utiliser les graines de ses propres légumes pour faire des semis. A vrai dire je n’avais même jamais pris le temps d’y réfléchir. Et chaque année je ne manque pas de faire chauffer ma carte bleue dans les jardineries pour acheter des graines. Aujourd’hui je me demande bien comment ce genre d’idée a pu germer dans ma tête. Surtout que je ne suis pas le seul dans ce cas ! Y aurait-il un travail de lobbying là derrière ?
Bref, c’est tellement facile de récolter ses graines que je ne vais plus m’en priver. Cette idée m’a ouvert de nouveau horizon. J’ai découvert qu’il y avait une volonté de préserver le patrimoine légume. Des jardinier luttent pour préserver des variétés anciennes, comme notamment de choux de saint Saëns,près de chez moi. J’ai pris conscience que le travail de sélection des jardiniers amateurs mérite d’être conservé, surtout quand on voit la vitesse de propagation des variétés hybrides. J’ai décidé de travailler avec des variétés fixées et de me lancer dans la sexualité des plantes .
La capacité de la nature à se régénérer
Mes actions pour favoriser la biodiversité dans mon potager restent facileà entreprendre et à la portée de tous. Je suis néanmoins surpris de voir comment de petites actions peuvent amener de grands changements. Voici quelques-unes de ces actions :
 Planter quelques fleurs mellifères et laisser quelques fleurs sauvage se développer permet de voir les insectes recoloniser votre jardin. Bien que je sois en pleine ville j’ai pu voir des insectes vraiment impressionnant. En laissant une place plus grande à la spontanéité de la nature, j’ai pu ainsi découvrir une nouvelle fleur : l’onagre. Elle a quasiment recouvert tout mon jardin, et je me dis qu’il y a surement une bonne raison à cela.
Planter quelques fleurs mellifères et laisser quelques fleurs sauvage se développer permet de voir les insectes recoloniser votre jardin. Bien que je sois en pleine ville j’ai pu voir des insectes vraiment impressionnant. En laissant une place plus grande à la spontanéité de la nature, j’ai pu ainsi découvrir une nouvelle fleur : l’onagre. Elle a quasiment recouvert tout mon jardin, et je me dis qu’il y a surement une bonne raison à cela.
Le retour des champignons fut aussi une découverte agréable. Depuis longtemps chaque saison je vais chercher des cèpes en forets et systématiquement je jette les épluchures dans mon jardin. Seulement je n’ai jamais vu un cèpe pousser. Par contre depuis que j’utilise le BRF, non seulement un réseau important de mycélium a colonisé le terrain, mais je vois aussi des champignons pousser çà et là.
Pailler le sol avec mes déchets verts et ma poubelle à épluchure ont considérablement modifié mon jardin. Avant je ne voyais par un ver, aujourd’hui il suffit que j’écarte un peu le mulch pour voir quantité de vers se recroqueviller. Le paillage offre un environnement propice au développement de la faune du sol. Aujourd’hui mon sol grouille de vie et le développement de mes légumes a progressé.
Les vers ne sont pas les seuls à investir le paillage, il y a aussi des bestioles moins sympas comme les limaces. Forcement ma première réaction de jardinier était de sortir le tue limace. J’avais quand même pris soins de rendre le poison inaccessible pour les autres animaux.
Après quelques sorties nocturne pour tenter de pulvériser mon ennemie, j’ai fini par renoncer, enlever mes pièges et me dire je laisse faire on verra bien.
Le laisser faire au potager.
Ce n’est pas facile de laisser ses salades se faire bouffer. Mais j’ai fini par me dire que cette quantité impressionnant de gastéropode allez bien finir par intéresser quelqu’un.  Au bout de quelques mois, j’ai vu les premiers carabes courir dans le potager. Un hérisson aussi à pointé son nez. Je ne dis pas que la population des limaces est déjà maintenue sous pression, mais la nature fait son travail et je suis sûr d’aller vers un équilibre. J’essaie de mettre en pratique les principes de l’agriculture sauvage.
Au bout de quelques mois, j’ai vu les premiers carabes courir dans le potager. Un hérisson aussi à pointé son nez. Je ne dis pas que la population des limaces est déjà maintenue sous pression, mais la nature fait son travail et je suis sûr d’aller vers un équilibre. J’essaie de mettre en pratique les principes de l’agriculture sauvage.
J’adopte cette politique pour tous maintenant, et je subi des pertes. Je ne vous dis pas mes pieds de tomates cette année. Mais j’ai quand même pu en profiter. Le mildiou a tout ravagé mi-aout avec le fort taux d’humidité. J’ai refusé de traiter a la bouilli bordelaise car son action sur les champignons n’est pas ciblé. Je n’ai même pas pris le soin de brûler les pieds contaminés. Je les ai laissé sécher sur place puis passé au broyeur. Je vous dirais l’été prochain comment se portent mes tomates. Je risque peut être de déchanter mais j’ai la conviction que plus mon jardin sera riche en biodiversité plus fortes seront mes cultures.
Apparence du potager naturel.
Depuis que je laisse la nature un peu plus libre je découvre une nouvelle réaction de mon entourage.
– Ba alors t’as laissé tomber ton jardin !
– Mais c’est la brousse chez toi
– Ba dit ! C’est pas très bien entretenu ton potager.
Notre vision du jardin est bien formatée, dans l’esprit de bon nombre de jardinier, un potager entretenu c’est un potager avec une terre totalement nu et découverte. C’est des légumes planté au cordeau et regroupé. Tout le contraire de ce qu’il faudrait faire ! Mais d’où nous vient cette pratique ? Comment a-t-on réussit à nous convaincre de procéder ainsi ? Sans vouloir imaginer le complot partout, j’imagine quand même que notre héritage de jardinier vient bien de quelque part. Qu’en pensez-vous ? Croyez-vous que nos méthodes de jardinages sont le résultat du travail du marketing des industriels de la chimie ?