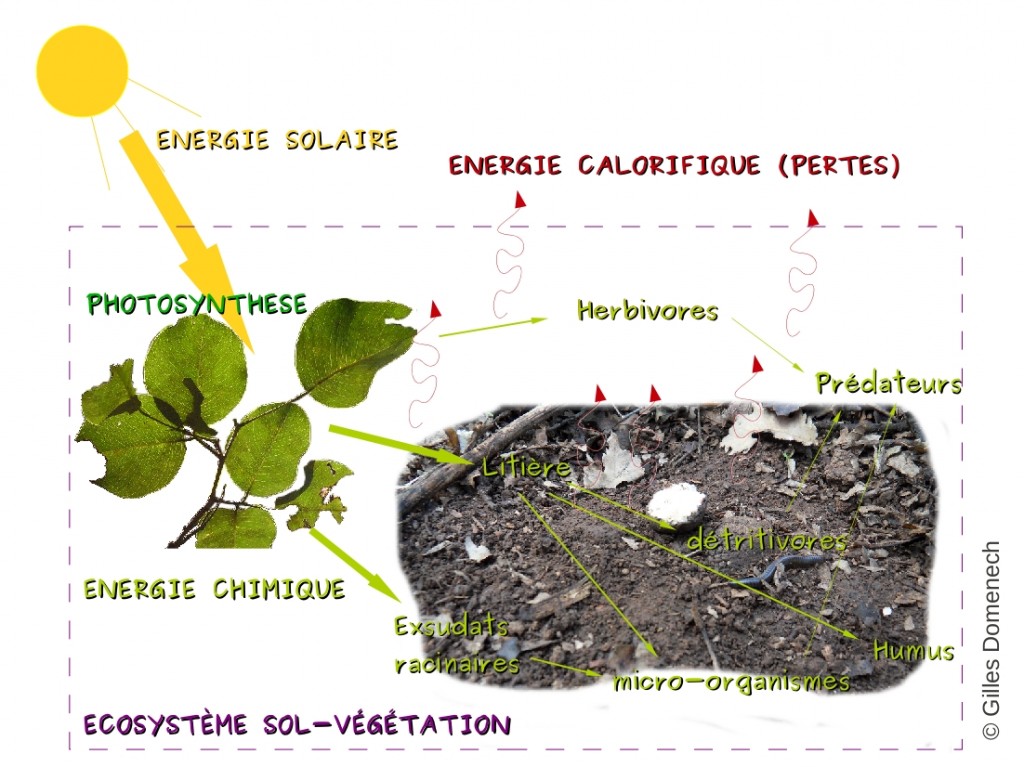Une pratique de plus en plus prisée des jardiniers et en particulier de ceux qui comme vous sont sensibilisés à l’importance de la vie dans le sol est la butte Lasagne. Concrètement, il s’agit d’une butte composée non pas de terre, mais d’une succession de couches de matériaux divers et variés et pour la plupart organiques. L’intérêt d’une telle pratique consiste en la valorisation de toutes sortes de matières organiques qui sont souvent considérées comme des déchets et aussi de pouvoir mettre en culture des terre très peu fertile, voire complètement artificialisées (tassées, goudronnées, bétonnées…), ce qui est particulièrement intéressant dans un contexte urbain notamment, mais qui peut aussi tenter les jardinier ruraux !

La suite de cette article est écrite à partir de textes originaux de Jacques, que vous connaissez tous, et de Caroline, lectrice, collègue et amie qui fait son jardin sur les coteaux du Gers.
Cette technique, mise au point par Patricia Lanza, une jardinière Américaine qui, ne sachant comment se débarrasser des déchets de son restaurant et du jardin, eut l’idée de les empiler par couches successives en alternant matières brunes (carbone) et matières vertes (azote), sur une épaisseur d’environ trente centimètres, le tout abondamment arrosé pour créer une fermentation, et planter des légumes sur ce substrat.
Les principes de « construction » sont les suivants :
– favoriser des sources de carbone variées pour apporter des sucres (tontes, épluchures…), de la cellulose (paille, carton, foin…) pour les lombrics, de la lignine (paille, BRF, sciure…)
– alterner le carbone et l’azote, ce dernier étant apporté par les tontes de gazon, les déchets de cuisine, les composts, le vermicompost…
– apporter des « inocula de faune et flore » divers et variés dans toutes la construction: compost (riche en micro-organismes), vermicompost (riche en micro-organismes eisenia à tous stades de développement), bois pourri (riche en champignons), purins de consoude ou autre (riche en micro-organismes) …
– on peut rajouter une poignée de basalte ou de cendres de cheminée pour booster la présence de sels minéraux
– penser à favoriser une structure aérée en plaçant des branches ça et là au fur et à mesure de la construction
– privilégier les matériaux locaux, qu’on a sous la main (ou on invite les voisins à déposer leurs tontes ou autres déchets verts qu’ils ont la méchante habitude de brûler)
– mieux vaut beaucoup de couches fines qu’une grosse couche trop épaisse (attention à l’excès de sciure qui peut « colmater » la butte)
– arroser (la butte doit être humide mais pas dégoulinante, comme une éponge dont on ne tirerait qu’une seule goutte si on l’essorait) et couvrir d’une bonne épaisseur de mulch (carton, paille, foin)
Voici par exemple ce qu’a réalisé cet été Caroline :
Dans une butte délimitée par vielles poutres de chêne, elle a disposé successivement directement sur l’herbe :
– Cartons ;
– Souche partiellement pourrie et branches de peuplier en décomposition (diam 5-10 cm) ;
– Vieux foin (riche en carbone, cellulose) ;
– Branches de haie fraîchement coupées, grosses adventices ligneuses (malvacées, bourraches en fin de floraison…) ;
– Déchets de cuisine (épluchures, marc de café, coquilles d’œufs… riches en azote et minéraux) ;
– Litière des lapins (50/50 carbone (paille)/azote (déjections animales))…
– Tontes fraîches (riches en azote) ;
– Copeaux/sciure de bois non traité en fines couches (très riche en carbone) ;
– Inoculum frais de compost ;
– Inoculum frais de vermicompost avec les eisenia encore présents ;
– Une avant-dernière couche plutôt humide (type déchets de cuisine ou adventices fraîchement arrachées) tout en haut, pour protéger les eisenias de la chaleur d’été ;
– Une bonne couche de mulch pour garder l’humidité de la lasagne (important pour le bon développement de la faune/flore du sol vivant): paille ou foin.
La lasagne a été bien arrosée entre chaque niveau de « construction » (eau de pluie, puits ou mare, de préférence). On peut aussi s’amuser à l’arroser avec un purin de consoude ou un autre type d’inoculum, ou même inviter les enfants et les visiteurs de passage à uriner dessus (excellente source d’azote) au grand bonheur de tous … on peut marcher dessus un peu pour tasser avec modération si l’on a mis beaucoup de branches.
Voici son récit de la mise en culture :
« Fin août, j’ai repiqué des plants de choux sur la butte expérimentale (qui ne fait plus que 20 cm de haut au lien de 40). La lasagne, après 2 mois sans arrosage malgré les fortes chaleurs gersoise de juillet et août et son exposition plein sud sans ombre, est « fraîche et humide ». Elle a l’aspect d’un terreau noir, à la consistance de semoule. Elle sent « bon » le sous-bois forestier (les champignons !).
Elle « grouille » tellement de vie (eisenia, cloportes) que je m’inquiète pendant 24 heures: toute cette faune va-t-elle se ruer sur les plants de choux et ne faire qu’une bouchée des racines, voire des parties aériennes ???

Fin septembre: les choux sont magnifiques, excellent développement foliaire, peu d’attaques de ravageurs malgré la conduite en bio sur une zone où la pression des altises est notoirement forte. Je ne les ai arrosés que 2 fois en 1 mois (une fois au repiquage puis une autre fois 2 semaines après): 1 L pour chaque plant à chaque fois »

De telles observation sont monnaie courante semble-t-il, Jacques a fait des observations semblables, du moins pour la première année, car la deuxième semble ne pas être aussi formidable. Voici le récit de son expérience et les réflexions qu’il en tire :
« Avril 2011 : avec l’aide de l’employé municipal et des institutrices nous avons installé un mini jardin pédagogique à l’école maternelle de Séron (Hautes Pyrénées). Je venais de lire le livre de Jean-Paul Collaert « l’art du jardin en lasagne ».
J’ai donc décidé de profiter de l’occasion pour tester la lasagne.
Le résultat a été extraordinaire (voir photos ici : http://lagranderecree.asso-web.com/) légumes et fleurs se sont développés de façon spectaculaire, et cela sans arrosage. Ce résultat m’a tout de même laissé perplexe quand à la teneur en nitrates de ces légumes.
Avril 2012 la lasagne s’était affaissée de dix centimètres, j’ai rajouté du compost maison pour compenser la perte de matière, et nous avons fait de nouvelles plantations. Et la, première surprise, les légumes ont eu beaucoup de mal à démarrer, ont végété, le sol s’est rapidement desséché et il a fallu arroser. Au cours de l’été, le jardin n’a pas été régulièrement arrosé et les légumes ont très peu donnés.
Ce que je retire de cette expérience :
La lasagne est un milieu artificiel avec de très bons résultats la première année puis un épuisement rapide des éléments nutritifs.
Elle nécessite beaucoup de travail et il vaut mieux avoir tous les matériaux sur place.
Le coté positif, est que cela permet de cultiver sur des sols pauvres, caillouteux, voire sur le béton ou le ciment. Ce peut être l’occasion de rassembler un groupe, travailler dans la convivialité et apprendre ainsi à recycler des matériaux destinés à la déchetterie. »
Quant à Caroline elle tire la conclusion suivante de son expérience :
« Même si ces lasagnes ne sont pas généralisables à l’échelle agricole, je pense qu’elles sont un bon exercice pédagogique pour identifier, localiser, et mettre en oeuvre des matériaux courants qui font réfléchir à la vie du sol, comprendre les grand principes agronomiques de l’azote/carbone, de la lignine/cellulose, de l’eau/air et de toute la belle vie qui s’installe là-dedans … et nous donne de belles récoltes en cadeau … et puis c’est ludique et même carrément libérant car c’est un vrai bazar (!), une cuisine qui n’est jamais la même en fonction des matériaux verts qu’on a sous la main (parties aériennes de vesces en juin, énormes verdures de courges en septembre). »
Voilà je vous invite à donner vos sentiments quant à ces deux témoignages et à nous partager vos expériences de buttes lasagnes et les réflexions que cette expérience vous inspire !