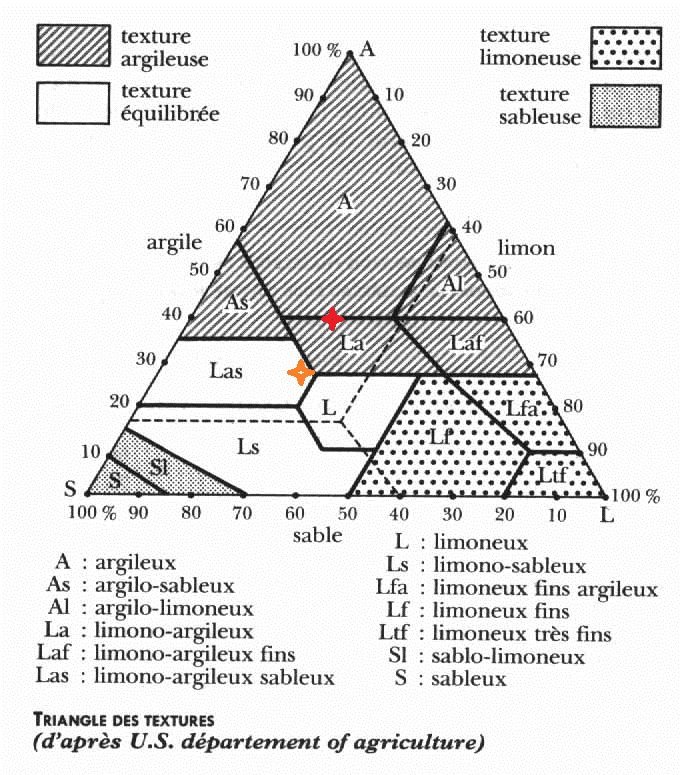Je vous partage aujourd’hui le témoignage d’un jardinier qui met en culture depuis plus de 20 ans la terre sablonneuse des Cévennes gardoises dans un esprit tout à fait convergeant avec l’approche que je propose dans ce blog.
Vie du sol et amendement
Le sol est un organisme vivant. Je ne le travaille pas, c’est lui qui le fait, il se régénère perpétuellement. Par l’ajout de sa propre biomasse due à l’ensoleillement et l’eau.
Les micro-organismes, champignons:
Je les nourris avec du compost de broussaille et fumier de mouton régulièrement, minimum 2 fois par ans, ce qui permet à tous les levains, levures est spores d’être toujours à fond et particulièrement l’été et de nourrir à leur tour les bactéries, qui nourrissent les vers de terre. Je fais balader ces laboureurs d’un endroit à l’autre en déplaçant régulièrement des tas de mulch. Laissant la place aux plantations.
De ce fait tous les vers de terre, scarabées labourent et les taupes leur courent derrière.
En surface beaucoup d’araignées, d’escargots, limaces et autres se nourrissent du compost frais produit sur place et empêchent les attaques sur légumes ou du moins les restreignent. Je couvre aussi les semis avec un voile.
Il m’arrive d’arroser en février si le temps est trop sec, pour garder toujours un levain actif.
Plantation de pomme de terre et travail du sol
J’arrache à 4 pattes la culture précédente, souvent navets ou crucifères qui viennent de fleurir, pour les abeilles; je range à droite et à gauche le mulch et crée un labyrinthe. Ensuite, je creuse un trou de 20 cm (à deux c’est mieux), car je ne butte pas les pommes de terre, et avant qu’il ne se referme, mon fils y jette une patate germée (tous les 40cm, les allées font 60 cm). Ensuite je me repose.
Trois semaines plus tard, je sarcle un peu la terre autour des pieds et là je ramène le mulch aux cols des patates. En règle générale, je n’ai plus besoin d’y revenir jusqu’à la récolte, sauf pour quelque grande herbe quand les patates sont en fleurs, ce qui permet d’aérer la terre un dernier coup.
Je sème une inter-culture (pois, maïs ou tournesol), souvent des haricots, à 10 cm de profondeur à la place du mulch, ce qui limite l’arrosage et permet à la plante de se nourrir profondément sans buttage, dans une terre qui est restée propre grâce au couvert et bourrée de micro éléments.
Ils naissent à l’ombre des patates et se mettent en concurrence d’ensoleillement, ce qui active les deux plantes. Et quand ils commencent la fructification à trois mois, il est temps d’arracher les patates, qui elles sont pratiquement en surface et qui ont consommé les résidus de navet. C’est là que je vois la trame du sous-sol créée par les taupes avec qui je travaille.
Leurs galeries sont énormes en fait c’est la seule fois de l’année où je vais en profondeur dans la terre, toujours à 4 pattes, sans outil ou juste une bineuse pour ne pas abîmer les patates.
Selon l’inter-culture, j’en remets une autre à la place (radis, navets, carottes…) En fait étant fainéant de nature, je ne travaille jamais la terre. Elle est toujours en production ou couverte.
Si je me fais gagner par une soit disant mauvaise herbe l’hiver, sur les terrains sans navet ou culture:
Eh bien, je suis content quand il y en a beaucoup car je mets une bâche noire 3 semaines et là quand je la retire tout est brûlé et j’arrache toujours à la main au col les plantes. Je dit que « j’arrache la moquettes ».
Ce qui permet au système racinaire de l’ex mauvaise herbe de rester en place et tenir une structure du sol parfaite.
La culture suivante prend la place des racines précédentes. Imagine un peu, c’est comme des autoroutes de nourriture pour la prochaine plantation.
Souvent quand je retire la bâche des germes de patates « blancs » de l’année d’avant sont présents et eux n’ont pas brulé, car la patate est en profondeur. Alors là super! Je laisse pousser 3 semaines, puis petit coup de griffe pour lever les adventices, je mulche avec l’herbe cramée et c’est reparti comme avant, je remets une inter-culture.
Paillage avec la laine de mouton issue de tonte fraîche.
Souvent le berger ne trouve pas preneur pour sa laine et en échange d’un coup de main je lui débarrasse et m’en sert de paillage aux jardins. Le résultat est époustouflant sur adventice cela brûle tout au bout de trois semaines due certainement à l’urée, suint et crottes collés à la laine et le manque de lumière.
Ensuite j’écarte un peu et repique des semis à port haut à l’intérieur. Les légumes deviennent énormes et avec le temps s’installe du mycélium sous la laine et une vie très dynamique. Aussi non je m’en sers comme paillage après la levée des semis et du premier binage. Cela est très agréable à mettre en place et très jolie.
La laine retiens beaucoup d’eau et de chaleur un peu comme un pull .au bout de 5 ans elle a disparu est laisse as la place une structure du sol « gluante argileuse » alors que je suis en terre acide sur sable granitique .que du bonheur !
L’arrosage
J’arrose le matin bonne heures étant au couchant par un système d’aspersion sans moteur à l’eau de source souvent je rajoute dans mon bassin des purins d’ortie en début de culture ou autre apport azotés je ne crains pas le mildiou étant en altitude est souvent ventés. Merci mamie
Disposition des cultures
Alors là comme pour le reste je me prend pas trop la tête.je respecte quelques règles du a la topographie des terres Cévenoles qui sont sur (cantou, faïsse ou bancel)c’est-à-dire avec des murs en pierres sèches bâtis sur roche mère. En haut des jardins j’ai 10cm de terre en bas jusqu’à trois mètres .alors vous l’aurais compris toutes les plantes hautes styles maïs, tournesol ou coureuses genre courge courgettes sont sur sol profond ce qui me permet de remonter de la matière organique qui rejoindrons les pieds de mur .Elles crées de l’ombre pour les plantes plus petites. J’aime bien aussi les mettre en concurrence ce qui oblige les plantes à se battre pour leur survie est les dynamise d’autant.
Souvent des semences de l’an passée germent et là c’est cadeaux je laisse faire.
Le tournesol me sert à nourrir les mésanges l’hiver sur ma terrasse ce qui remplace la télé et ensuite elles vont manger les insectes aux jardins. Quand il fait froid minette en mange une. C’est en libre-service s’il y’as trop de taupe minette m’en ramène aussi sur la terrasse en échange de bonne nourriture
Le maïs sert de tuteur pour les haricots grimpants.
Ensuite je sème ou repique ou de la place se libères mon jardins est en perpétuel mouvement les carrées et autre rectangle de culture évolue au fil du temps.