En novembre dernier, Didier de la chaîne youtube Mon Potager Plaisir, a profité d’assister à une de mes formations sur le maraîchage sur sol vivant pour m’interviewer sur la réduction du travail du sol. Ceci a été tourné en une seule prise juste avant de démarrer la formation entre 8h45 et 9h, rapide, mais efficace !
Et bien sûr, c’est l’occasion de découvrir l’excellente chaîne youtube de Didier qui est également maraîcher dans le magnifique département du Cantal.






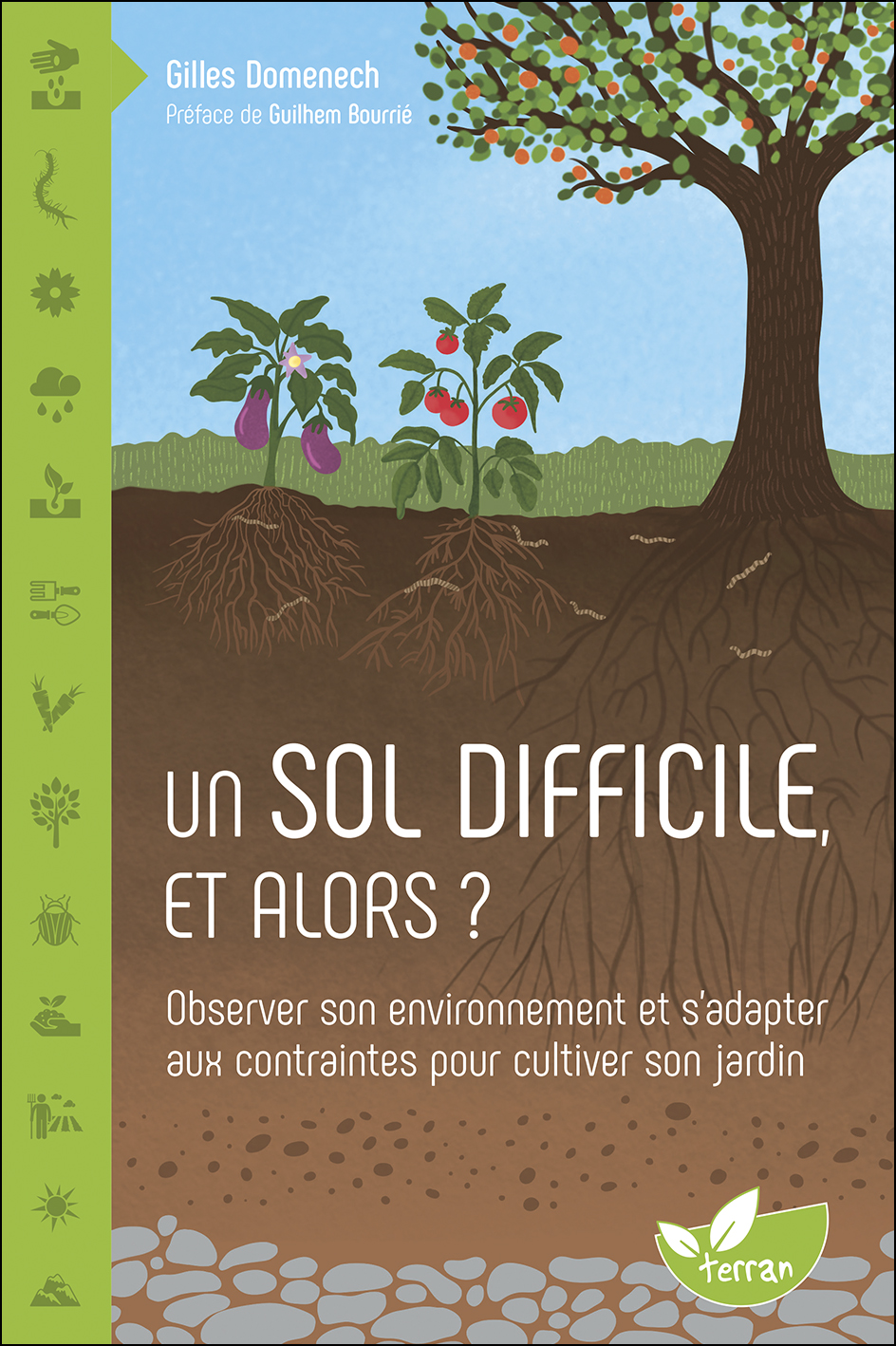
























Intéressant. Adepte également du non-travail du sol, j’estime néanmoins que quelques limites ou du moins précisions sont nécessaires.
Une comparaison a été effectuée entre quatre types de travail du sol : labour à 30 cm, à 18 cm, travail réduit à 15 cm, semis direct sous couvert (Vian 2012). Au bout de cinq ans, on ne constate pas de différence en termes de matière organique (Bispo 2017) mais, par contre, des structurations fort différentes des communautés bactériennes (Lelièvre 2011), avec pour résultat des activités enzymatiques différentes (Gattin 2012), de même au sujet des nématodes.
Le labour traditionnel, à 30 cm, rend les ressources plus disponibles, tandis qu’un travail superficiel ou un semis direct sous couvert augmente la complexité du réseau trophique et donc sa stabilité (Villenave 2011).
On retrouve l’idée selon laquelle remuer la terre l’aère, et donc accélère la décomposition de la matière organique d’où une meilleure disponibilité des ressources, mais perturbe nématodes et champignons.
Une autre idée y correspond : la remise à zéro, avec redémarrage presque uniquement bactérien et perturbation voire destruction des autres communautés, dont les pathogènes.
Par contre, on tire de l’étude la conclusion qu’en sol non remué, les ressources pourraient manquer, un sol riche est donc nécessaire, aussi attendra-t-on trois ans de bonnes pratiques avant de cesser de remuer la terre ; ou bien, on acceptera une production moindre ; ou encore, on ajoutera de l’engrais.
En conclusion, les réponses sont ds votre texte : ils faut savoir comment l’agrosystème va fonctionner et anticiper dans toutes ses pratiques, ce qui peut passer par un investissement en engrais par ex.. pour atteindre un nouvel équilibre. Pr ma part, et peu importe le type de sol ou les contextes, je n’ai vu et ne vois (en agricole) QUE des intérêts à réduire le sol (travail, adventices..), au mini ne pas le retourner, le mieux étant aucun travail. Le labour n’est qu’une pratique de court terme qui ne règle non seulement rien puisqu’il faut aussi fertiliser, desherber etc.. , mais qui n’investit pas sur l’avenir.
Je souscris tout à fait à votre commentaire !
J’en profite pour rappeler qu’une plante est contexte-dépendant car immobile, à nous de fournir le bon contexte au non moment.
Puisque je rencontre une âme favorable ou, du moins, un commentaire intéressant, je vous livre ci-dessous quelques notes personnelles sur lesquelles j’aimerais des commentaires, aussi bien positifs que négatifs, y compris de l’animateur du blog et de l’auteur de la vidéo :
Le brassage de la terre par les vers rapporte en surface 30 kg* de terre enrichie et sans cailloux par m2 et par an (Bouché 2014), à l’opposé du labour qui enfouit la bonne rerre et remonte les cailloux ; labour ne pas confondre avec le bêchage initial puis si nécessaire, sur 20 à 30 cm, d’une couche qu’on souhaite homogène, en marapichage comme au potager.
*27 kg/m2 en moyenne en France mais jusqu’à 5 fois plus en prairie fertile (fumée).
La mouette consomme beaucoup de vers de terre qu’elle digère en un quart d’heure comme tout oiseau. Le labour a attiré les mouettes à l’intérieur des terres (Bouché 2014), et non les décharges, comme on l’a cru.
L’idée de favoriser les vers dans les cultures ne date pas d’aujourd’hui (Lal 1989) mais l’étude complète est demeurée sans suite chez nos agronomes. À la même époque (Laissus 1985), l’usage d’herbicides à l’automne, une manière paradoxale de nourrir les vers de terre par les herbes mortes, a permis de dynamiser leurs populations. Le lombrimix accumulé en surface pendant l’intersaison constitue un excellent lit de semis au printemps, sans labour. Enfin (Granval 2001), le semis direct est le moyen de conserver le stock de vers. Au contraire (Hennuy 1982), le déchaumage le réduit de moitié et le labour des deux tiers. Or, dès cette époque (Frankinet 1979), il a été démontré que le labour n’est pas indispensable.
À l’inverse, dans un sol remué, la minéralisation très faible est certes néfaste en cas de toxique mais positive pour l’enrichissement en matière organique. Ainsi, l’absence de bêchage, de croc ou de grelinette, ou encore de labour, permet un stockage de carbone (Virto 2012) et donc un moindre dégagement de dioxyde de carbone. Un tel stockage est dû à la protection physique de la matière organique à l’intérieur des agrégats ou par adsorption (Six 2000) sur le complexe argilo-humique.
Le sans-labour, de même que le non-travail du sol au potager, ou un travail léger de surface, augmente la densité des vers de terre (van Capelle 2012) ainsi que leur diversité (Pelosi 2009), particulièrement en faveur des anéciques (Kladivko 2001).
Le non-travail du sol améliore également la biodiversité des sols (Perès 2014), avec un effet particulièrement net sur les collemboles (El Titi 2003), les nématodes (Villenave 2009) et la diversité microbienne (Andrade 2003). Mais des effets négatifs existent aussi (van Capelle 2012) plus souvent qu’habituellement prétendu sur Internet, effets qui rejoignent de nombreuses autres études sur l’accumulation de pathogènes avec la notion de « sol fatigué » (Davet 1996) ou certaines pullulations. Aussi le non-travail du sol doit-il être pondéré par la nécessité d’une remise à zéro périodique, volontaire ou telle que liée à la récolte de tubercules.
Le brassage de la terre par les vers rapporte en surface 30 kg* de terre enrichie et sans cailloux par m2 et par an (Bouché 2014), à l’opposé du labour qui enfouit la bonne rerre et remonte les cailloux ; labour, ne pas confondre avec le bêchage initial puis si nécessaire, sur 20 à 30 cm, d’une couche qu’on souhaite homogène, en maraîchage comme au potager.
*27 kg/m2 en moyenne en France mais jusqu’à 5 fois plus en prairie fertile (fumée).
Je réponds d’abord à ton premier commentaire, qui me semble très juste et je ne vois pas vraiment où est la contradiction par rapport à ce que j’ai pu dire.
Sur le second com, merci pour le travail de synthèse fort bein sourcé 😉 (dois-je comprendre comprendre que tu as unaccès aux publis scientifiques, si oui, ça m’intéresse 🙂 ).
il y a juste une phrase qui me fait un peu tiquer : « À l’inverse, dans un sol remué, la minéralisation très faible est certes néfaste en cas de toxique mais positive pour l’enrichissement en matière organique. » Au contraire, le travail du sol favorise la minéralisation (c’est d’ailleur un de ses principaux rôles et est justement néfaste au à l’enrichissement en MO, il a ainsi fait passer les taux de MO des sols français de 4% en moyenne dans les années 60 à environ 1,5% aujourd’hui… (les chiffres sont de mémoire donc approximatifs).
Oui bien sûr, il fallait lire dans un sol NON remué. Remuer oxygène et donc entraîne un boum bactérien, avec pour conséquence une minéralisation accrue, on est d’accords.
Pour le premier commentaire, il n’y a pas de contradiction, c’était juste pour dire que dans certains contextes, un travail du sol au potager ou en maraîchage (et seulement dans ces deux cas) est utile.
Quant aux sources, je prépare une synthèse sur divers sujets et des affirmations non sourcées, que je tente de sourcer, donc. Parce que je fais des conférences, mais aussi dans un autre but. Ma bible est Google Scholar et l’inspection systématique de toutes les bibilos que je trouve. un travail titanesques, à 3 heures par jour, je n’ai pas fini !
Tes chiffres de mémoire sont bons, mais c’est parce que nous avons de la chance ; la plupart de nos sols sont calcaro-argileux, il y avait donc un bon CAH qui a limité la casse, sinon nous aurions comme aux USA un dust-bowl.
Oui, tu as tout à fait raison 😉 !
Je suis aussi parfaitement d’accord sur le fait qu’un travail du sol, léger, voire parfois profond est utile dans certaines circonstances.
Concernant google scholar, c’est un effet un excellent moteur de recherche que j’ai beaucuop utilisé par le passé mais la plupart des articles ne sont pas accessibles (ou alors seulement l’abstract), comment fais-tu pour y accéder ?
Vidéo très intéressante. Merci Gilles.
Pour l’instant, j’ai de la chance, j’en ai trouvé de nombreux (je crois que ça a changé depuis les bisbilles avec Elsevier). Si on n’a que l’abstract, on peut aller voir sur les pages des auteurs, souvent on les trouve. Enfin, pour le reste, je demande à un copain chercheur : il m’envoie des articles si la bibliothèque est abonnée et il connaît un site où on peut presque tout avoir mais il n’a pas souhaité me dire lequel (c’est du piratage).
Par ailleurs, parfois, pour mon usage, je me contente de l’abstract. L’article n’est souvent pas meilleur. J’ai travaillé sur la méthodologie dans les années quatre-vingt mais mon directeur de recherche ne m’a pas permis de poursuivre tant cela aboutissait à démolir la plupart des études. Aujourd’hui, ce n’est pas mieux, et en outre la plupart des articles ne font plus que trois pages (publish or perish). On trouve également la plupart des thèses mais, à mon époque, on aurait appelé ça mémoire de recherche et non pas thèse !
J’ajoute, et cela peut intéresser tout le monde, que dans notre domaine, les études sont en majorité faites en labo sur principalement deux plantes (Arabidopsis et Brachypodium) et donnent très rarement des suites sur le terrain ; et quand c’est le cas, le terrain confirme rarement (je parle de biologie, pédologie, microbiologie car en agronomie il y a beaucoup d’études sur parcelles comparées). Bien sûr, il a la métagénomique, où il y aurait beaucoup à redire, et la tomographie mais on en est aux balbutiements. Quant à la modélisation des systèmes complexes, courante en écologie et en biologie, elle commence tout juste à se développer en pédologie. Reprenant une idée de Bouché, je parlais de syndrome de la motte de terre : on ne sait pas décrire une simple motte. Toutefois, depuis 2015 cela change. À défaut de réellement savoir la décrire, on parvient à la modéliser.
L’étude de la motte s’effectue par microtomographie aux rayons X (Chenu 2017), puis représentation 3D et résolution d’équations (Monga 2014), ou bien utilisation des pixels 3D de l’image 3D puis modélisation de dynamique des fluides (Vogel 2015).
Preuve de l’avancée des travaux, on sait désormais prédire avec précision la vitesse de décomposition de la matière organique présente de manière naturelle (sans ajouts au laboratoire) dans la motte étudiée (Chenu 2017). Or cette vitesse de décomposition est un intégrateur de l’activité des micro-organiqmes et de la dynamique de leurs communautés. Reste à étendre la modélisation à un sol en place, une perspective à l’échelle des décennies.
Mais je m’égare…
Bonjours à tous,
Un message juste pour apporter mon point de vue quant à la littérature existante sur le sujet ou études et spécialistes qui fleurrissent depuis peu.
Pour avoir pratiqué d’abord les TCS puis le SDCV sur mon exploitation agricole et travaillé le sujet, avec des groupes d’agriculteurs intéressés par les tcs et les SDCV depuis 25 ans (expé, vulgarisation..), j’ai pu trouver dans la littérature tout et son contraire, que ce soit au niveau des recherches que de la vulgarisation. Et encore aujourd’hui.. !, mais çà s’améliore ( ?). D’abord, parce que chacun y va de sa sensibilité, de son expérience, et aussi de son honnêteté intellectuelle ou de son lobbying (parce ce qu’il y en a de très gros derrière toute cette thématique, car ce sont des pratiques qui remontent aux sources !!..). Aussi parce que les situations de départ sont différentes et que les techniques et itinéraires pratiquées sont multiples.
Toute cette biblio (que vous citez), ok elle existe, mais il faut prendre beaucoup de hauteur et relativiser leurs conclusions : il faut TRIER !. et bien positionner les pièces pour reconstituer le puzzle
Pour ma part, je reproche donc à beaucoup d’études et de (pseudo) scientifiques :
1/ le manque de description et d’analyse du contexte initial (surtout de quoi on part, quelles étaient pratiques précédentes ce qui donne un avis sur l’état initial du sol..) et le manque de relativisation des résultats à ce contexte.
2/ de greffer à chaque fois ces pratiques ou ces recherches dans un contexte d’agriculture conventionnelle (ce qui peut être moins vrai en petite surface, maraichage, potager..).
Quelles questions sont posées aux dispositifx de recherche ? met on les dispositifs expé dans les conditions d’y répondre ? par ex, peut on faire du semis direct en maïs en routine ? si pour y répondre on met une expé sur un terrain régulièrement labouré et travaillé les années précédentes, on ne peut y répondre car ce n’est pas un terrain « regénéré », représentatif de ce qu’on est censé obtenir en SDCV.. , donc on ne répond pas précisément à la question, on mélange tout !. Testons après prairie de 7-10 ans !, je vous assure qu’on n’aura pas le même résultat !. Idem si on n’a pas adapté la rotation, pas adapté la fertilisation, pas adapté le matériel génétique (variétés..) qui ne réagit plus comme en labour+engrais+phytos.. . etc.. (on pourrait en débattre longtemps..).
Et dernière chose, ce sont des pratiques basées sur une biodiversité complexifiée, des équilibres reconstitués notamment quand on parle de ravageurs (limaces..), or on a très peu de situation agricole où positionner des expé où ceci est le cas (peut être au potager ?).
3/ Au final, un manque de prise de hauteur et de relativisation des résultats mesurés (qui sont sans doute bons dans les conditions des études..), très souvent un manque de créativité et un manque d’humilité des auteurs face à des techniques nouvelles, qui perturbent la posture du « scientifique », du « connaissant », du « conseiller » et peuvent les rebuter (j’en ai fait l’amer expérience..), sans aborder le « publish or perish ».
Tout ceci amène au final une généralisation des conseils (« çà marche pas », « il faut faire çà.. »), ce qui conduit souvent à des plantages chez ceux qui s’essayent, et des déceptions irréversibles.
Il faut bien prendre conscience qu’on ces techniques ne s’inscrivent plus dans une agriculture de « recettes » mais dans une agriculture d’observation, d’analyse, de compréhension et d’anticipation, et pour anticiper, il faut avoir lu, vu, partagé, analysé.., donc pratiqué.
Sans culture et expérience terrain du sujet, il est très difficile pour un « novice » de s’en faire une opinion claire et de sauter le pas sereinement dans ses pratiques (c’est ce qui se passe en agriculture). Il faut être un passionné, et C’EST PASSIONNANT !.
Sans doute que mon commentaire vous apparaitra peu constructif mais je voulais le passer, en pensant aux futurs pratiquants.
re
quand vous parlez que « ..le travail du sol même léger est nécéssaire .. dans certaines circonstances.. », pouvez vous préciser ces circonstances ?.. car je pense que c’est le genre d’affirmation trop peu précise et généraliste qui prête à confusion, et désoriente les gens..
.. car je peux être d’accord mais sur le fond et s’il fallait se fixer un point de mire, un travail profond et même surperficiel est pénalisant (sans doute moins à petite échelle au potager qu’en parcelle agricole).
Comme vous allez le voir, on est plutôt d’accord mais avec des points de vue différents (vous, un agriculteur-chercheur, moi un ex-scientifique (écosystémique), maraîcher et surtout au potager (et je n’écris qu’à propos du potager). De plus, vous êtes dans la production, moi pas (jeune retraité).
Si vous démarrez sur la qualité des études et notamment la méthodologie, on n’a pas fini car, comme je l’ai écrit, ce fut mon sujet (notamment l’influence des méthodes et de l’observateur sur le résultat) et le résultat des analyses n’est pas brillant.
Néanmoins, il faut faire avec ce qu’on a et, bien entendu, observer. Je commence mes conf par un long moment sur la notion de contexte, qui me semble fondamentale. Contexte de l’étude, contexte scientifique (révolution en cours), contexte du jardinier (s’il n’a jamais vu de maraîchage ou un vrai jardin il est fier de ses légumes faméliques), contexte du jardin (terrain, environnement, exposition, etc.), contexte de la plante pour comprendre comment elle fonctionne, contexte agriculture/potager/agrément, etc. Et la plante, un organisme contexte-dépendant sensible à d’informes modifications.
Si on a compris cela on comprend pourquoi beaucoup d’études sont contradictoires, et pourquoi beaucoup de résultats pourtant bien étayés ne fonctionnent pas partout, pourquoi également une méthode utilisée une année ne fonctionne pas l’année suivante dans le même jardin, etc.
Au sujet, des études, je pense avoir trié les références, et j’en ai éliminé beaucoup, mais si vous en trouvez des douteuses, signalez-le moi. D’une manière générale, la science avance d’abord par des préétudes (un terme qui n’existe plus, tout simplement parce que presque toutes en sont), puis, à force, on peut établir des statistiques, ainsi que des revues, qui commencent à dégager des tendances, qu’on affine et ainsi de suite. Mais, par essence, la science ne dira jamais rien de tel ou tel cas particulier (sauf à l’analyser spécifiquement) car la science est toujours statistique, et ne peut être autrement, par définition.
On comprend donc que même avec une bonne pratique et de bonnes connaissances, on est en quelque sorte seul face à son terrain, et l’intuition demeure nécessaire, de même que le fait d’accepter qu’immanquablement, on fera des erreurs. Au potager, ce n’est pas bien grave, en agriculture c’est une autre affaire.
En ce qui me concerne, je ne parle QUE du potager car je n’ai pas de pratique ailleurs hormis en maraîchage, et chaque jour je mesure la difficulté de transposer un résultat, presque toujours issu soit de l’agriculture industielle soit de parcelles de l’INRA ou autre, ou, pire, de laboratoire (90 % des études scientifiques, 20 % des études agronomiques ? Au pif), de le transposer, donc, au potager.
Car, je ne le répéterai jamais assez, le potager (et le maraîchage) ne fonctionne pas comme l’agriculture, pour deux raisons majeures : peu de contraintes au potager, pas de problèmes de ressources vu les tailles réduites (même avec 1500 m2 comme c’est mon cas). On peut donc y passer le temps qu’on veut, rater une production, apporter tout ce qu’on veut pour améliorer la terre (le coût demeurant minime). Autre différence, de taille, au potager on ne cultive pas vraiment un sol, mais plutôt de la terre, une couche grumeleuse assez homogène d’une trentaine de centimètres d’épaisseur ; la remuer est moins grave qu’un sol agricole. Aussi, au potager on n’a ni mycorhizes ni nodulation ou, du moins peu, alors qu’en agriculture (ou en agrément, en verger) on peut compter dessus.
Quant à votre question, il demeure nécessaire de remuer ou griffer en surface pour des raisons pratiques, de facilité, ou pour semer certaines graines comme les carottes (mais à vrai dire, je le fais sans toucher à la terre, en rajoutant une couche de compost au stade terreau par-dessus) ; plus important, en cas de maladies du collet où il suffit en général d’éloigner le pathogène de sa zone d’attaque, on conseille souvent de retourner mais il me semble, de mon expérience, qu’un griffage au râteau suffit ; et dans quelques cas particuliers, après une crue pour aérer la vase qui s’est déposée (cas chez moi), et parfois après un gel ou de très fortes pluies si malgé nos précautions la partie supérieure a été déstructurée (par exemple, on venait d’arracher juste avant la pluie pour sauver la récolte sans avoir eu le temps de couvrir).
Etc. Comme vous le dites, il faut réfléchir à chaque situation, la replacer dans son contexte, et agir en conséquence. Sachant que chaque jardinier a ses préférences et que donc tous n’agiront pas pareil, avec pour autant de bons résultats s’ils ont bien travaillé avant et que leurs pratiques et leurs connaissances sont correctes.
Pour conclure, je dis souvent : rien n’est vrai dans l’absolu, tout dépend du contexte.
Et j’aime bien dire que si les technosciences sont souvent dogmatiques (principes absolus, applications absolues), Internet (articles, commentaires) est souvent relativiste (principes relatifs ou contestés, applications absolues du genre ma technique est la meilleure et pour tout dire la seule), eh bien au potager (et ailleurs, mais avec plus de difficulté) on peut choisir une démarche différente, la pondération, avec la recherche de principes forts (études scientifiques, mais pas seulement) et surtout d’applications relatives (ne jamais appliquer aveuglément, multiplier les techniques, changer d’année en année, etc.).
J’ai écrit « d’informes modifications » au lieu d’infimes !