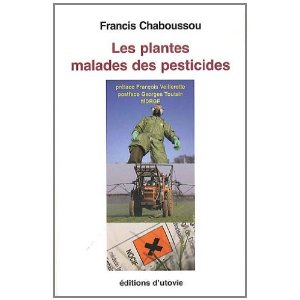Je n’ai pas l’habitude de tenir un discours de militant politique, mais l’actualité nous rattrape et une loi votée le 28 novembre dernier par le parlement français m’amène à écrire le texte qui suit.
Qui se doute que la loi sur les semences récemment voté aggravera le risque d’insécurité ? Cette loi est-elle en conformité avec les principes de durabilité que tout le monde est en droit de voir appliquer ? Il est fortement permis d’en douter !
Que s’est-il passé exactement le 28 novembre ?
Tout simplement le vote d’une loi qui oblige les agriculteurs français à se mettre en conformité d’un règlement européen datant de 1993. Celui-ci stipule que tout agriculteur qui réutilise une partie de sa récolte pour la ressemer, c’est-à-dire qui utilise de la « semence de ferme », devra payer une redevance, fixée pour le moment à 3€/ha et destinée à financer la recherche (comprendre : les multinationales de la semence). Plus précisément, cette redevance, dite « contribution volontaire obligatoire » (sic !) s’applique pour 21 espèces en plus du blé tendre (espèce pour laquelle elle était obligatoire depuis 2001), pour peu que la semence utilisée aie été sélectionnée depuis moins de 25 ans. Plus grave encore, en dehors de ces espèces, l’utilisation des semences de fermes est purement et simplement interdite (cas du soja et de la totalité des légumes), cette interdiction s’applique également pour les couverts végétaux, mettant ainsi en péril le développement de techniques extrêmement prometteuses mais encore mal maîtrisées. Cela risque de plus de retarder les objectifs de la directive nitrates qui demande une couverture des sols à 100% en période d’interculture. Le meilleur moyen de réussir cet objectif crucial pour la société ne consiste t-il pas à ce que l’agriculteur, dans sa phase d’apprentissage, ressème au moindre coût et en toute simplicité sa propre semence ?
Sur tout cela on ne peut rien, c’est voté et il faudra désormais s’y conformer ou être hors la loi ! Et inutile d’espérer quoi que ce soit d’une éventuelle alternance politique car l’opposition, pourtant forte de sa récente conquête du sénat n’a même pas été capable de faire contester un amendement du projet. Cela aurait permit de renvoyer le texte dans cette dernière assemblée qui aurait alors pu le rejeter ! La seule solution est donc d’alerter au maximum l’opinion publique dans toute sa diversité en expliquant au mieux le thème de la semence qui nous concerne tous, même ceux qui vivent toute l’année au milieu du béton des villes et ne mettent jamais les mains dans la terre ! Il s’agit là ni plus ni moins que de l’enjeu de notre sécurité alimentaire !
La sécurité alimentaire des peuples dépend des semences de fermes
Pour bien comprendre cela, je vous invite à vous pencher sur les différents types de semences qu’utilisent les agriculteurs :
– Les semences de population sont des mélanges de plusieurs lignées. Elles sont la réserve de biodiversité des gènes. La culture des populations permet d’identifier des lignées performantes dans un milieu et un climat donné.
– Les lignées sont des plantes d’une même espèce qui présentent un ensemble de caractères homogènes et stabilisés. Elles sont issues des populations, et sélectionnées pour répondre à une problématique précise. Il est possible d’améliorer la rusticité ou la sensibilité d’une plante aux maladies. Une lignée se reproduit à l’infini par reproduction autogame. Une variété est une lignée sélectionnée à laquelle on a simplement donné un nom.Il est possible de facilement reproduire ces semences, elles peuvent être améliorées si l’on continue leur sélection.
– Les hybrides F1 sont issus du croisement de deux lignées, ce sont en quelque sorte des « métis » végétaux, la grande différence entre eux et les lignées provient de l’homogénéité exceptionnelle de la 1ere génération hybride F1 qui bénéficie de surcroit de l’effet hétérosis qui améliore, selon les types de plantes, la production et la rusticité. Cependant, le semis des semences issues d’hybrides (2e génération F2) exprime à nouveau l’hétérogénéité des lignées parentes, moins performantes (perte de l’effet d’hétérosis, lois de Mendel), supprimant l’intérêt de la réutilisation des semences par l’agriculteur.
– Enfin les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) sont des plantes auxquelles on « colle » un gène au génome afin d’apporter une réponse rapide face à une problématique donnée. Les plantes OGM de première génération intègrent, dans la majorité des cas, un gène de résistance à un herbicide ou un ravageur.
Les deux premiers types de semences (populations et lignées) existent depuis les débuts de l’agriculture et peuvent être reproduits sans difficultés par les agriculteurs. Ils doivent cependant maintenir la qualité des semences et les améliorer constamment. Ce travail de maintient et de développement de la diversité génétique se réalise aussi bien par l’industrie semencière que par les agriculteurs. Ces semences permettent, dans tous les cas, de répondre rapidement à un besoin alimentaire. Elles garantissent la compétitivité, la réactivité et la performance économique de l’agriculteur en même temps que la sécurité alimentaire pour la société. En effet, en cas de pénurie de semences, la mise en culture est immédiate et les résultats garantis.
Les deux autres types (hybrides F1 et OGM) sont issus du travail de développement de l’industrie semencière depuis 100 ans environ. Ces semences permettent d’améliorer la production globale. Elles améliorent aussi l’offre de diversité génétique. Leur obtention nécessite un long travail de sélection, difficile et parfois aléatoire, que rémunère le prix. Leur production doit être renouvelée tous les ans. Ce travail spécifique de production de semence peut être aléatoire car soumis au climat. Les semences de mauvaises qualités, non conformes, ne peuvent alors plus être commercialisées. Un risque de pénurie existe bel et bien. Même si ces semences s’avèrent très performantes, notamment les hybrides, elles sont soumises aux stratégies commerciales des firmes. Elles ne peuvent donc pas constituer l’essentiel de la stratégie de développement autour de la sécurité alimentaire.
Il y a là une problématique non évoquée et non résolue par la loi.
Comment avoir une stratégie d’agriculture durable qui garantisse l’approvisionnement et la sécurité alimentaire des peuples ?
Le regard porté sur les différentes semences montre qu’il serait suicidaire pour une société de s’en remettre aux seules ingénieries commerciales de brevetage du vivant. Les technologies sont actuellement déjà rémunérées par les règles commerciales. Une stratégie d’agriculture durable implique que l’agriculteur puisse avoir accès sans restriction à son patrimoine génétique traditionnel, c’est-à-dire aux semences de populations et de lignées. Cet accès au semis sans restriction doit être un véritable service public compte tenu du service rendu au public par les agriculteurs. La sécurité alimentaire impose un accès sans conditions à ces semences. Ces semences hébergent le meilleur potentiel de réactivité !
Quelle est la réalité d’un système commercial en cas de problème majeur, une crise économique, une catastrophe ou un conflit ? Que se passerai-t-il si les multinationales détenant le monopole de la semence venaient à faire faillite ? Il est aisé de comprendre que la technologie n’est sans doute pas apte à répondre au souci élémentaire de réactivité et de sécurité.
Imposer le paiement de taxes sur ces semences semble être un bien mauvais choix. Ce système de mutualisation ne permet en aucune sorte de garantir la sélection de semences de qualité par les obtenteurs. Un simple regard sur les pratiques de sélection ayant entrainé une perte de rusticité des semences pour accroitre la dépendance des agriculteurs à la phytopharmacie durant les 20 dernières années montrerait aisément les dérives et les complicités passées.
Comment continuer ?
S’il semble acquit qu’une taxe ne résoudra pas le problème que pose le devoir de durabilité, il faut bien organiser la préservation et la sélection des semences de population et de lignées.
Il faudra inventer un nouveau modèle de sélection et de production. La régionalisation et l’adaptation des semences aux différentes situations, semble être la meilleure solution. La sélection locale permet l’adaptation locale et, en même temps, une très forte diversité compte tenu des nombreux territoires existants. Cette réserve et cette diversité génétique profiteront aussi bien aux agriculteurs qu’aux semenciers. Ceux-ci n’auront qu’à piocher dans le fond génétique développé afin de proposer de nouvelles solutions technologiques encore plus performantes aux clients visés. La durabilité est une question de responsabilité. Ainsi, il semble logique que les semenciers, principaux bénéficiaires des lignées pour leur technologie, en financent aussi le développement. Mais cette proposition comporte en contre partie que les innovations puissent se développer en toute sérénité conformément aux règles sanitaires édictées.
La société doit mener ce débat. Il en va de sa sécurité alimentaire !
Vous pouvez reproduire ce texte à volonté pour faire connaître ce problème autour de vous, en espérant que l’opinion publique amène ce débat au devant de la scène politique