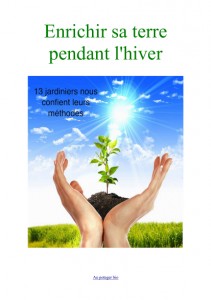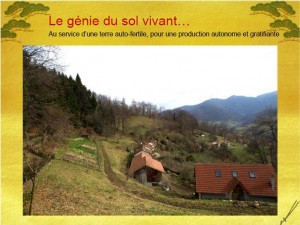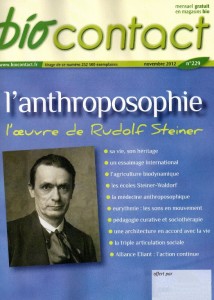Ces dernières semaines, j’ai à plusieurs reprises été amené à parler du thème des apport de MO à l’automne et de ce qui peut se faire et ce qui ne devrait pas être fait. Ce thème semblant être une préocupation pour nombre d’entre vous j’y décidé d’y consacré ce nouvel article :
Minéralisation d’automne et fuite de nitrates
Avant d’entrer dans les détails, revoyons quelques éléments de théories développés plus en détail un article que j’ai publié il y a un an: minéralisation d’automne et fuite de nitrates.
En résumé, il en ressort qu’à l’automne les sols sont (généralement) chauds et humides, ce qui favorise l’activité microbienne et donc la minéralisation des matières organiques. Une des conséquence de cela est que l’azote contenu dans ces matières organiques se retrouve massivement libéré sous forme de nitrates qui risquent d’être lixiviés (donc perdus pour le sol et les cultures à venir) vers les nappes phréatiques, risquant en plus de polluer ces dernières (même si on est à 100% bio !).
Le travail du sol éventuel vient fortement aggraver le phénomène, l’automne n’est donc pas la bonne saison pour monter vos buttes permanentes si vous souhaitez cultiver ainsi !
En revanches deux solutions permettent de limiter, voire annuler ce phénomène : l’apport de MO très carbonée (BRF, paille, feuilles mortes…) ou la mise en place d’un couvert végétal capable de capter ces nitrates.
La première solution n’est rien d’autre que celle mise en oeuvre chaque année par nos forêts tempérées, la seconde est celle qui permet aux prairies et autres systèmes herbacés de conserver cet élément si précieux qu’est l’azote.
Revenons donc à nos amendement organiques : certains sont donc très intéressant à apporter maintenant car ils sont très riche en carbone et relativement peu en azote. D’autres en revanche, relativement riches en azote seront à proscrire maintenant et au contraire bienvenus au printemps! Les scientifiques parlent de rapport carbone/azote ou encore C/N. On pourrais discuter de la pertinence de cet indice, mais dans le cas qui nous intéresse ici, il donne des tendances relativement justes.
On considère généralement qu’un amendement organique au C/N situé aux alentours de 25-30 sera neutre du point de vue de la libération d’azote minéral (nitrates, ammonium…) dans le sol car les micro-organismes consomment 25 à 30 fois plus de carbone que d’azote.
En conséquence, en dessous de ce rapport C/N on favorise la libération d’azote et au dessus, au contraire on immobilise l’azote minéral du sol. C’est à cause de cela qu’un apport de BRF au printemps provoque une faim d’azote parfois très problématique !
Quant aux matières organiques du sol, elles ont un C/N de 10 à 12, et sont donc très vulnérable à la minéralisation d’automne : les cultures et couverts végétaux implantés en fin d’été et en automne n’ont donc pas besoin de fertilisation supplémentaire, l’azote fourni par la minéralisation de l’humus leur suffit !
Du coup, vous l’aurez compris, à l’automne, si vous n’avez plus de cultures en place, il faudra éviter les amendements organique au C/N inférieur à 25 et de préférence en choisir un parmi ceux dont le C/N est très largement supérieur.
Voici le C/N de quelques matières organique organiques que vous êtes susceptibles d’utiliser pour vous guider dans vos choix:
Engrais organiques : <5
Gazon et autre matières végétales vertes : 7 à 10
Déchets de cuisine : 10 à 25
Fumier de volailles : 10 à 15
Fumier peu pailleux : 15 à 20
Fumier pailleux : 20 à 30
Compost mûr de fumier : 10 à 15 uivant le type de fumier
Compost jeune de fumier : 15 à 25 suivant le type de fumier
Compost « maison » : 25 à 30
Foin : 25 à 35
Feuilles d’arbres : 40 à 80
pailles de céréales : 50 (avoine) à 150 (blé)
BRF : 50 à 150 suivant les essences et le diamètre des branches broyées
Sciures : > 150 et pouvant atteindre 1000 pour certains résineux.
Lorsque viendra la printemps, ce sera tout le contraire : les matériaux à C/N élevé seront à éviter à cause de la faim d’azote qu’ils risque de provoquer, ou alors être utilisés uniquement en surface (paillage) alors que les matériaux à C/N bas seront à favoriser afin de libérer des nitrates qui aideront vos cultures printanières à démarrer.
Et pour ceux qui sont en milieu tropical (si, si, vous êtes nombreux à me lire depuis les tropiques), oubliez cet article car le problème ne se pose par pour vous : vos sols sont toujours chauds et les périodes humides correspondent à celles où le sol est cultivé, donc les nitrates libérés seront utilisés pour la croissance des cultures !
Quels amendements organiques apporter à l’automne,
Ces dernières semaines, j’ai à plusieurs reprises été amené à parler du thème des apport de MO à l’automne et de ce qui peut se faire et ce qui ne devrait pas être fait.
Avant d’entrer dans les détails, revoyons quelques éléments de théories développés plus en détail un article que j’ai publié il y a un an: minéralisation d’automne et fuite de nitrates
En résumé, il en ressort qu’à l’automne les sols sont (généralement) chauds et humides, ce qui favorise l’activité microbienne et donc la minéralisation des matières organiques. Une des conséquence de cela est que l’azote contenu dans ces matières organiques se retrouve massivment libéré sous forme de nitrates qui risquent d’être lixiviés (donc perdus pour le sol et les cultures à venir) vers les nappes phréatiques, risquant en plus de polluer ces dernières (même si on est à 100% bio !). Le travail du sol éventuel vient fortement aggraver le phénomène, l’automne n’est donc pas la bonne saison pour monter vos buttes permanentes si vous souhaitez cultiver ainsi ! En revanches deux solutions permettent de limiter, voire annuler ce phénomène : l’apport de MO très carbonée (BRF, paille, feuilles mortes…) ou la mise en place d’un couvert végétal capable de capter ces nitrates.
La première solution n’est rien d’autre que celle mise en oeuvre chaque année par nos forêts tempérées, la seconde est celle qui permet aux prairies et autres systèmes herbacés de conserver cet élément si précieux qu’est l’azote.
Revenons donc à nos amendement organiques : certains sont donc très intéressant à apporter maintenant car ils sont très riche en carbone et relativement peu en azote. D’autres en revanche, relativement riches en azote seront à proscrire maintenant et au contraire bienvenus au printemps! Les scientifiques parlent de rapport carbone/azote ou encore C/N. On pourrais discuter de la pertinence de cet indice, mais dans le cas qui nous intéresse ici, il donne des tendances relativement justes.
On considère généralement qu’un amendement organique au C/N situé aux alentours de 25-30 sera neutre du point de vue de la libération d’azote minéral (nitrates, ammonium…) dans le sol car les micro-organismes consomment 25 à 30 fois plus d’azote que de carbone.
En conséquence, en dessous de ce rapport C/N on favorise la libération d’azote et au dessus, au contraire on immobilise l’azote minéral du sol. C’est à cause de cela qu’un apport de BRF au printemps provoque une faim d’azote parfois très problématique !
Quant aux matières organiques du sol, elles ont un C/N de 10 à 12, et sont donc très vulnérable à la minéralisation d’automne : les cultures et couverts végétaux implantés en fin d’été et en automne n’ont donc pas besoin de fertilisation supplémentaire, l’azote fourni par la minéralisation de l’humus leur suffit !
Du coup, vous l’aurez compris, à l’automne, si vous n’avez plus de cultures en place, il faudra éviter les amendements organique au C/N inférieur à 25 et de préférence en choisir un parmi ceux dont le C/N est très largement supérieur.
Voici le C/N de quelques matières organique organiques que vous ees susceptibles d’utiliser pour vous guider dans vos choix:
Engrais organiques : <5
Gazon et autre matières végétales vertes : 7 à 10
Déchets de cuisine : 10 à 25
Fumier de volailles : 10 à 15
Fumier peu pailleux : 15 à 20
Fumier pailleux : 20 à 30
Compost mûr de fumier : 10 à 15 uivant le type de fumier
Compost jeune de fumier : 15 à 25 suivant le type de fumier
Compost « maison » : 25 à 30
Foin : 25 à 35
Feuilles d’arbres : 40 à 80
pailles de céréales : 50 (avoine) à 150 (blé)
BRF : 50 à 150 suivant les essences et le diamètre des branches broyées
Sciures : > 150 et pouvant atteindre 1000 pour certains résineux.
Lorsque viendra la printemps, ce sera tout le contraire : les matériaux à C/N élevé seront à éviter à cause de la faim d’azote qu’ils risque de provoquer, ou alors être utilisés uniquement en surface (paillage) alors que les matériaux à C/N bas seront à favoriser afin de libérer des nitrates qui aideront vos cultures printanières à démarrer.
Et pour ceux qui sont en milieu tropical (si, si, vous êtes nombreux à me lire depuis les tropiques), oubliez cet article car le problème ne se pose par pour vous : vos sols sont toujours chauds et les périodes humides correspondent à celles où le sol est cultivé, donc les nitrates libérés seront utilisés pour la croissance des cultures !